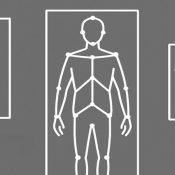L’université de Caen Normandie a accueilli, du 24 au 27 juin 2025, le groupe de travail « Céphalopodes, pêcheries et cycle biologique » du Conseil international pour l’exploration de la mer. Jean-Paul Robin, professeur en écologie marine au laboratoire MERSEA, revient sur ce temps fort de collaboration scientifique sur la scène européenne.
Quel est le rôle du groupe « Céphalopodes, pêcheries et cycle biologique » (WGCEPH en anglais) ?
Depuis sa création, en 1992, au sein du Conseil international pour l’exploration de la mer (ICES), le groupe de travail WGCEPH rassemble les expertises sur la biologie des céphalopodes et la gestion de la ressource. La directive-cadre sur la stratégie pour le milieu marin (DCSMM), qui constitue le pilier environnemental de la politique maritime de l’Union européenne, reconnait l’écosystème marin comme un patrimoine précieux devant être protégé. À ce titre, les céphalopodes font l’objet d’une attention particulière. Les seiches, poulpes et calmars jouent effectivement un rôle essentiel dans les écosystèmes marins et constituent une ressource économique importante pour de nombreuses pêcheries artisanales en Europe. Ces espèces sont très prisées en Europe – notamment dans les pays du sud de l’Europe. Les enjeux économiques sont donc importants et un suivi des stocks est indispensable pour garantir une exploitation durable de la ressource.
Quels sujets ont été abordés lors de cette réunion ?
Le groupe de travail qui s’est réuni à Caen a mobilisé 28 spécialistes de 11 nationalités différentes, dont des collègues de Belgique et des Pays-Bas – ce qui est très significatif pour nos travaux, car le changement climatique modifie la répartition géographique des céphalopodes, désormais observés en mer du Nord. Mieux comprendre les déplacements de population entre la Manche et la mer du Nord est essentiel. Des représentants de l’Ifremer et du Muséum national d’histoire naturelle de Concarneau ont également partagé leurs observations sur l’abondance des poulpes sur les côtes bretonnes.
Les présentations ont porté sur les résultats des travaux en cours dans des domaines tels que la biologie des céphalopodes, les pêcheries et les méthodes d’évaluation. Nos échanges vont donner lieu à la production d’un rapport détaillé, qui sera remis au conseil scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer en septembre 2025.
Quelles avancées scientifiques ont été exposées ?
L’université de Caen Normandie est pionnière dans l’application de modèles d’évaluation des stocks de céphalopodes exploités par la pêche. Nous avons notamment présenté nos derniers diagnostics concernant les calmars et les seiches. Les diagnostics sont rassurants pour les calmars mais les évaluations des stocks de seiches sont plus préoccupantes : hélas, il est difficile de prendre des mesures en l’absence de diagnostic partagé entre la France et la Grande Bretagne. La gestion de la ressource nécessite aussi un accès aux statistiques de pêche qui passe par des procédures longues au regard de la courte vie des animaux, si bien que les constats ont lieu « après coup ». Autre résultat marquant : le développement de nouvelles méthodes d’analyse, fondées sur l’intelligence artificielle, pour déterminer l’âge des céphalopodes. Le poulpe vit entre un an et un an et demi, tandis que la seiche vit deux ans – leur durée de vie est donc très courte, d’où l’importance de surveiller la croissance pour mieux préserver la ressource.
Jean-Paul Robin (laboratoire MERSEA, équipe FORSEAS), est membre du WGCEPH depuis 1993. Il a présidé ce groupe d’experts de 2002 à 2004 et co-présidé de 2014 à 2019.