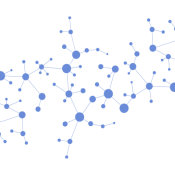Avec 150 000 nouveaux cas par an en France, l’accident vasculaire cérébral (AVC) reste la première cause de handicap acquis de l’adulte. Cette avancée de la recherche caennaise ouvre la voie à des traitements personnalisés et plus sûrs.
Le laboratoire PhIND de l’université de Caen Normandie vient de publier dans la revue Theranostics une avancée majeure dans la lutte contre l’accident vasculaire cérébral ischémique (AVC). Les scientifiques, sous la direction de Denis Vivien (UNICAEN) et Thomas Bonnard (Inserm), ont mis au point un nouveau traitement, un agent dit « théranostique » (qui allie une action thérapeutique à une action diagnostique) capable de détecter et d’éliminer les micro-caillots invisibles persistants dans le cerveau à la suite d’un AVC. Ces micro-caillots, invisibles aux techniques d’imagerie classiques, continuent souvent d’obstruer la microcirculation cérébrale, aggravant les lésions et limitant la récupération des patients.
Cette étude démontre qu’il est possible de combiner imagerie moléculaire et traitement dans une même approche. Elle ouvre une perspective nouvelle : celle d’une médecine de précision de l’AVC dans laquelle les cliniciens pourraient simultanément voir, mesurer et traiter les obstructions cérébrales. Cette approche pourrait transformer la prise en charge de l’AVC, en permettant de traiter plus de patients, plus tôt, et de suivre en direct l’efficacité du traitement
Denis Vivien, professeur à l’université de Caen Normandie et directeur de l’unité PhIND
L’IO@PDA@tPA – c’est son nom – est le premier agent théranostique pour les AVC, capable de diagnostiquer et de traiter simultanément une pathologie en combinant imagerie et thérapie. Administré chez la souris, cet agent a permis de visualiser les micro-thrombi en temps réel grâce à l’IRM, de les dissoudre efficacement avec une dose de tPA quatre fois moindre que dans le traitement standard, de réduire significativement la taille des lésions cérébrales et d’accélérer la récupération fonctionnelle sans risque accru d’hémorragie. Aujourd’hui, moins de 20 % des personnes victimes d’un AVC peuvent recevoir du tPA, car la dose standard est jugée trop risquée pour bon nombre de personnes. Ainsi, un traitement efficace à faible dose permettrait de soigner plus de personnes, plus tôt et plus sûrement. « Cette approche ciblée ouvre la voie à une thrombolyse plus sûre, potentiellement applicable à un plus grand nombre de patients », explique Denis Vivien. Prochaine étape : des essais cliniques, avant d’envisager une administration à l’Homme. Le chemin est encore long mais les pistes pour une meilleure prise en charge de l’AVC sont prometteuses.
Ces recherches s’inscrivent dans le cadre du projet CaeSAR, qui bénéficie d’une aide de l’État gérée par l’Agence nationale de la recherche au titre de France 2030 portant la référence ANR-23-EXES-0001 et de la Région Normandie.