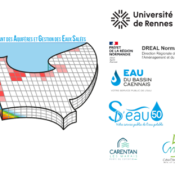Diana Zidarov, chercheure à l’Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) et professeure associée à l’Université de Montréal, était l’invitée de l’UFR de Psychologie et l’unité de recherche NIMH du 5 au 9 mai 2025. Sa venue était l’occasion de partager son expertise dans le domaine des « sciences de l’implantation » – un domaine scientifique qui étudie les méthodes pour favoriser l’adoption de nouvelles pratiques ou technologies dans la pratique clinique.
Les « sciences de l’implantation », au plus près des besoins cliniques
Pendant 15 ans, Diana Zidarov a exercé comme physiothérapeute en milieu clinique. Sa spécialité : la réadaptation en déficience physique, notamment auprès des personnes amputées. Une expertise qui nourrit aujourd’hui ses travaux dans un champ de recherche bien spécifique : les « sciences de l’implantation ».
Depuis le début des années 2000, le Canada a joué un rôle de premier plan dans le développement des sciences de l’implantation. Ce domaine scientifique encourage une approche de la recherche étroitement liée à la pratique clinique, mobilisant à la fois des méthodes quantitatives, qualitatives et participatives pour tenir compte des réalités du terrain.
À l’origine de ces méthodes, un constat : « même si des chercheurs et chercheuses mettent au point un nouveau traitement efficace, celui-ci ne sera pas nécessairement adopté ou mis en œuvre dans la pratique clinique. » Pourquoi ? Et surtout comment faire pour favoriser son utilisation ? « Ce n’est pas parce qu’une solution répond à un besoin qu’elle est forcément adaptée à la réalité du milieu clinique, explique Diana Zidarov. C’est pourquoi il est primordial que la recherche collabore avec les praticiens et les praticiennes, afin de pouvoir mettre en place des stratégies qui facilitant l’adoption et la pérennisation des innovations en santé. »
Mettre en œuvre un projet d’implantation, étape par étape
Basés sur des approches participatives, ces projets de recherche peuvent s’étendre sur plusieurs années. À titre d’exemple, Diana Zidarov travaille notamment sur le développement et l’implantation d’un registre clinique des personnes ostéointégrées au Québec. Cette technologie novatrice permet d’implanter une tige en métal dans l’os du membre amputé, implant auquel une prothèse peut être directement rattachée. Depuis 2019, ce traitement bénéficie d’un financement public au Québec : « mais nous ne disposons pas encore d’assez de données sur l’efficacité de ce traitement, sa sécurité, ses complications… Les cliniciens m’ont donc sollicitée car ils avaient besoin de données probantes qu’un suivi à long terme peut fournir. »
En effet, les sciences de l’implantation prennent en compte plusieurs facteurs qui peuvent influencer la mise en œuvre d’une intervention dans son contexte clinique. Par exemple, cela peut inclure l’acceptabilité de l’intervention, sa pertinence pour le milieu clinique ou la faisabilité de son implantation. L’objectif est d’adapter les propositions d’intervention à la réalité de l’établissement clinique afin qu’elles puissent être réellement utilisées, et cela sur le long terme. Ainsi, pour un même traitement, chaque projet d’implantation peut varier du tout au tout selon les établissements et les spécialités. « En tant que professeure associée, mon rôle est vraiment d’accompagner les cliniciens et cliniciennes dans la mise en œuvre de nouvelles interventions basées sur des données probantes ». À ce titre, Diana Zidarov agit comme « facilitatrice », travaillant au plus près des cliniciens et cliniciennes, dans une démarche collaborative.
Tisser du lien et croiser les expériences
À l’origine de la visite de Diana Zidarov à l’université de Caen Normandie se trouve sa rencontre, à l’automne 2024, avec Clémence Lelaumier, doctorante en neuropsychologie au laboratoire NIMH et spécialiste de la rééducation post-AVC. Dans le cadre de sa thèse, Clémence Lelaumier s’est rendue à Montréal pour approfondir ses connaissances sur les sciences de l’implantation. « J’avais une double problématique : d’un côté, trouver des ressources pour mener une démarche qualitative, et de l’autre, en apprendre plus sur la recherche participative. » C’est donc dans cet esprit que Diana Zidarov et elle ont commencé à échanger. Leur collaboration a abouti sur le co-développement d’une intervention de réadaptation pour rééduquer l’héminégligence. En effet, cette difficulté à percevoir l’environnement et les sensations d’un seul côté pourrait être accompagnée via la technologie de la réalité virtuelle auditive – projet qui a d’ailleurs été présenté à l’occasion du concours Têtes Chercheuses 2025.
Quelques mois plus tard, les deux chercheuses se retrouvent à l’université de Caen Normandie. « C’est l’occasion de travailler ensemble, au même endroit, pour planifier et organiser la suite de la recherche », explique Clémence Lelaumier. Car elles ne mènent pas ce projet seules : grâce au soutien du laboratoire NIMH et de son directeur Hervé Platel, elles bénéficient de ressources pour préparer leurs outils de collectes de données, mais aussi pour se rapprocher de l’écosystème de recherche et de clinique normand. Ainsi, Diana Zidarov et Clémence Lelaumier collaborent notamment avec les laboratoires CIREVE et COMETE (notamment avec Leslie Decker), dans l’optique de créer un outil via la réalité virtuelle auditive pour évaluer le sentiment de présence dans le cas d’une héminégligence.
La venue de Diana Zidarov permet donc de créer des liens concrets avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le développement et l’implantation future de cette intervention innovante visant la rééducation de l’héminégligence. Ainsi, Diana Zidarov a pu rendre visite à l’Institut de Médecine Physique et de Réadaptation (IMPR) de Hérouville, au sein duquel seront mises en place les interventions prévues par l’étude ; l’occasion de découvrir le contexte à accompagner dans le déploiement de l’intervention.
La communication scientifique, un axe majeur pour l’avancée d’un projet d’implantation
La venue de Diana Zidarov a aussi été l’occasion d’échanger sur les méthodologies de recherche qualitative avec différents membres de l’unité NIMH, notamment dans le cadre de 2 projets actuellement en cours, coordonnés par Mathilde Groussard. Ainsi, Diana Zidarov a également mené une table ronde avec des doctorants et doctorantes du laboratoire NIMH, au cours de laquelle elle a partagé des conseils sur les approches participatives.
Dans cette même démarche, Diana Zidarov a également proposé une conférence ouverte à toutes et tous pour présenter son champ d’études. « C’était pour moi un bon moyen de commencer ce temps d’échange. C’est vraiment très enrichissant de sensibiliser autant les étudiants et étudiantes que les futurs cliniciens et cliniciennes sur les sciences de l’implantation et l’apport des méthodes qualitatives. »
En effet, la question du transfert des connaissances est cruciale. « En tant que chercheur ou chercheuse, nous pourrions nous contenter de publier nos articles et nos conclusions, et puis de passer à d’autres projets. Toutefois, il est également de notre responsabilité de disséminer ces connaissances issues de la recherche afin de rejoindre un public plus large et de maximiser l’impact de nos travaux. »