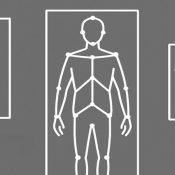Depuis dix ans, le programme 13-Novembre étudie l’onde de choc provoquée par les attentats du 13 novembre 2015. Avec une question centrale : la construction et l’évolution, au fil du temps, de la mémoire des attentats.
Un programme hors normes sur la mémoire des attentats du 13 novembre 2015
« La mémoire évolue dans le temps », explique Francis Eustache, neuropsychologue, co-responsable scientifique du programme 13-Novembre. « Elle est façonnée par les expériences individuelles, les liens sociaux et les récits collectifs, qui, en s’entremêlant, participent à la construction identitaire de l’individu comme de la société. » C’est pour étudier cette mémoire en construction que le programme 13-Novembre a été lancé au lendemain des attentats, sous l’impulsion du CNRS et de l’Inserm. Ce programme s’appuie sur une cohorte de 1 000 volontaires, dont les témoignages sont recueillis lors de quatre campagnes d’entretiens réparties sur dix ans. Face caméra, ces participants – témoins directs et indirects des attentats – racontent leur soirée du 13 novembre 2015 et l’impact du souvenir sur leur vie quotidienne. « Ces témoignages nous permettent d’évaluer, dans la durée, la persistance des souvenirs, les effets du traumatisme et les processus de résilience à l’œuvre. » Ces récits sont analysés par des équipes de recherche en histoire, neuropsychologie, droit, sociologie, lexicologie ou encore en mathématiques – pas moins de 27 thèses ont été initiées à ce jour.
Mémoire et traumatisme : ce qui se joue dans le cerveau
Ces attaques, d’une violence extrême, ont entraîné chez de nombreux témoins et rescapés un trouble de stress post-traumatique (TSPT). « Le TSPT se caractérise par la survenue brutale d’images, de bruits ou d’odeurs qui s’imposent à l’individu – comme si l’événement était en train de se rejouer », précise Francis Eustache. Ces pensées intrusives, émotionnelles et sensorielles, sont particulièrement éprouvantes : elles s’accompagnent souvent d’une grande détresse psychologique et de stratégies d’évitement. Cependant, l’apparition et l’évolution des symptômes varient considérablement d’une personne à l’autre. Bien que confrontés au même choc traumatique, certains développent un TSPT chronique, d’autres voient leurs symptômes s’atténuer avec le temps… quand d’autres, encore, n’y seront jamais confrontés.
Le projet Remember a donc été mis en place pour décrire très précisément les manifestations et mécanismes du TSPT. Cette étude est menée auprès de 180 personnes, dont 120 directement exposées aux attentats – la moitié d’entre elles ayant développé un TSPT. Cette cohorte est, elle aussi, suivie au cours de quatre campagnes d’entretiens, qui incluent des examens en imagerie médicale réalisés au centre Cyceron de Caen.
Quand le mécanisme de l’oubli dysfonctionne
Comment surgissent ces pensées intrusives ? Pourquoi certaines personnes parviennent-elles à les bloquer ? Pour répondre à ces questions, l’étude Remember s’appuie sur une approche dite « think-no think ». « Il ne s’agit pas de soumettre ces personnes à de nouvelles images traumatisantes, tient à préciser Francis Eustache. Concrètement, le protocole consiste à apprendre des associations mot-image – par exemple, le mot « bateau » associé à l’image d’un arbre. Si le mot « bateau » est écrit en vert, le participant laisse venir l’image de l’arbre à son esprit. Si le mot « bateau » est rouge, il doit, au contraire, la bloquer. Cette approche nous permet de visualiser avec précision, à l’IRM, la capacité des individus à inhiber, ou non, des intrusions. »
Cette étude est pilotée par Pierre Gagnepain, chercheur à l’Inserm : les premiers résultats ont été publiés en 2020 dans la revue Science. « Ce qu’on observe chez les personnes ayant développé un TSPT, indique Pierre Gagnepain, c’est un dysfonctionnement des réseaux de contrôle qui, normalement, régulent l’activité de l’hippocampe – une structure clé de la mémoire. » Un nouvel article publié en 2025 dans Science Advances met en évidence la plasticité de ces réseaux cérébraux : « Chez les personnes ne souffrant plus de TSPT, les examens en IRM montrent que ces mécanismes de contrôle de la mémoire se sont reconstitués au fil du temps. » Le projet Remember se poursuit pour affiner la compréhension de ces mécanismes, qui laissent entrevoir des possibilités de guérison. Les recherches passent désormais à l’échelle de la molécule grâce à une autre modalité d’imagerie – la tomographie par émission de positions (TEP) –, capable de révéler les processus biologiques en cours. « Ce qui nous intéresse, c’est le rôle joué par un neurotransmetteur, le GABA, et ses récepteurs localisés au sein de l’hippocampe », précise Pierre Gagnepain. Cette piste pourrait ouvrir la voie vers de nouvelles thérapies pour améliorer la prise en charge du TSPT et favoriser le processus de résilience.
Une soirée exceptionnelle à l’université de Caen Normandie, le 6 octobre 2025
Le 6 octobre 2025, l’université de Caen Normandie a organisé une soirée pour faire le point sur les dix années de recherche du programme 13-Novembre. Ouvert au public, cet événement a réuni les participants, les équipes scientifiques et les partenaires institutionnels, pour évoquer les grandes découvertes et les retombées pour la société.





![]interstice[, le festival international des arts visuels, sonores et numériques](https://www.unicaen.fr/wp-content/uploads/2025/12/Festival-Interstice-175x175.jpg)