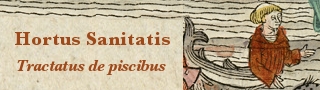Chapitre 70
[1491/vue 41] Capitulum LXX1capitulum LXIX Prüss1 caput 69 1536.
Pinna [la pinne1La pinna est ici la perna. Voir s. v.
Perna.] et plais [la plie2La plais est probablement
la plie (Pleuronectes platessa Linné,
1758), citée à côté du passer par Peter
Artedi, Synonymia nominum piscium, 1738,
p. 30, parmi les Pleuronectes Linné, 1758.
Cependant, Pline (Plin. nat. 32, 150)
désigne ce poisson sous le nom de passer. Plais signifie la plie, selon Ueltschi 1994, 709,
dans sa traduction du Mesnagier de Paris :
« Plays [les plies] et quarrelet sont aucques d’une nature. La plus
grant est nommee plays, et la petite quarrelet, et est tavellee de
rouge sur le dos ; et sont bons du flo de mars et meilleurs du flo
d’avril. Affaictiez par devers le dos au dessoubz de l’oreille, bien
lavee, et mise en la paelle, et du sel dessus, et cuite en l’eaue
comme un rouget, et mengiez au vin et au sel ». En outre, il a dû
exister une homonymie pour la plais, car le
même nom désigne aussi le pecten selon
Vincent de Beauvais (VB 17, 99, 3), traitant de l’urtica. L’édition de Douai porte une note
marginale : Pecten id est plais gallice, « Le
pecten, c’est-à-dire, en français, le plais ». Voir Urtica,
ch. 102. ?] [+][VB 17, 79 De pinna et plaice [-]][+]
[Prüss1/vue 34] Pinna et plais [+][VB 17, 79 De pinna et plaice [-]][+]
Renvois internes : Pinna : cf. Aureum vellus, ch. 8 ; Perna,
ch. 68.
Lieux parallèles : Pinna dans TC, De pina
(7, 61) ; AM, [Pyna] (24, 92
(47)).
[1] [•] VB 17, 79, 1Pline, livre 9. [•] Plin. nat. 9,
142-143La pinne est un poisson de l’espèce des coquillages. Elle naît dans les fonds limoneux ; elle se
tient toujours verticale et ne se rencontre jamais sans son
compagnon, appelé pinnotère, ou par d’autres pinnophylax3Le
pinnotère ou pinnophylax est de fait un petit crabe, « gardien de
la pinne » : voir De Saint-Denis 1947, 87-88 ; D’Arcy Thompson
1947, 202. : c’est une petite squille, ou chez d’autres individus, un crabe, qui est son parasite. La pinne s’ouvre, offrant aux petits poissons son corps
aveugle. Ils s’y précipitent aussitôt et, gagnés par un excès
d’audace, ils la remplissent4L’édition de 1536 a ajouté la suite du texte de
Pline : « Le guetteur, qui épiait ce moment, en avertit la pinne
par une légère morsure » (De Saint-Denis 1955, 83).. Mais
alors elle se referme, étouffe tous les captifs et accorde une
part à son associé5Le mode
d’alimentation des pinnes (piégeage de petits poissons) est
fantaisiste.. Cela augmente mon étonnement de voir que
certains aient refusé aux animaux aquatiques toute
intelligence.
[1] [•] VB 17, 79, 1Plinius libro IX. [•] Plin. nat. 9, 142-143
— Concharum
generis et pina est. Nascitur in limosis, subrecta semper nec
umquam sine comite, quem pinoteren uocant, alii pinophylacem, id
est squilla parua, aliubi cancer dapis adsectator. Pandit se pina,
luminibus orbum corpus intus minutis piscibus praebens. Adsultant
illi protinus et, ubi licentia audacia creuit, implent eam. Hoc
tempus speculatus index morsu leui significat. Illa conpressu
quicquid inclusit exanimat partemque socio tribuit. Quo magis
miror quosdam existimasse aquatilibus nullum inesse sensum.Pinna est piscis concharum generis. Nascitur in limosis, subrecta semper
nec umquam sine comite, quem pinnocherem2pinnotheren 1536
pinnotherem VB. vocant, alii
pinophilacem3pinophilacem 1491
pinnophylacem 1536 VBd., id est squilla4suilla
1491 Prüss1 VB.5L’apparat de De Saint-Denis 1955 à Plin. nat. 9, 142 fait
état des variantes : squilla Barb. chilla codd. La leçon suilla (« truie », d’où l’illustration) de 1491
et de l’édition Prüss1 étant absurde, nous
avons opté pour squilla, de l’édition de
1536, conformément au texte de Pline (cité en note de sources),
bien que Vérard traduise par « suile ». Sur la squilla, voir De Saint-Denis 1947, 109 ; D’Arcy
Thompson 1947, 104. parva, alibi6aliubi VB2 alicubi VBd. cancer, dapis assectator. Pandit autem se, luminibus
orbum corpus intus minutis piscibus praebens. Assultant illi7illi correximus ex Plin. : alii 1491 Prüss1 1536 VB. protinus et, ubi licentius8licentia VB.9L’adverbe licentius, bien que fautif (voir Plin. nat. 9, 142-143, cité en note de
sources) n’est pas absurde ; aussi l’avons-nous conservé. Ubi licentia audacia crevit est ainsi traduit
par De Saint-Denis 1955, 83 : « enhardis par l’impunité du
piège ». audacia crevit, implent eam10post eam add. hoc tempus spiculatus (spec- Plin.) index, morsu levi
significat 1536 ex Plin.. At illa,
ore compresso, quicquid concluserit exanimat11examinat 1491 Prüss1 VBd. partemque
socio tribuit. Quo magis miror existimasse quosdam aquatilibus
nullum inesse sensum12Pline emprunte à Aristote (Arist. HA 547 b 15-18 et Arist. HA 547 b 25-28)..
[2] [•] VB 17, 79, 2D’après le Liber de natura
rerum. [•] TC 7, 61La pinne est de l’espèce des coquillages, et elle a un corps rond. Le mâle et la
femelle ne se déplacent jamais l’un sans l’autre. La pinne ouvre ses valves à la lune et s’offre aux petits
poissons comme si elle était morte : ceux-ci s’y précipitent
aussitôt et, gagnés, [•] VB 17, 79, 2comme on l’a dit, [•] TC 7, 61par un excès d’audace, ils remplissent ses valves. Mais
alors la pinne, sentant qu’elle est pleine, étouffe en se
refermant toutes les proies qu’elle a prises.
[2] [•] VB 17, 79, 2Ex Libro de naturis rerum13La notice de Thomas de
Cantimpré est reprise presque à l’identique, à l’exception de
la phrase qui correspond à la fin du paragraphe de Pline cité
précédemment. Pline ne dit rien de l’accouplement du mâle et
de la femelle. Thomas de Cantimpré (comme Albert le Grand) a
dû prendre le pinnotère – comes de la
pinne – pour son mâle.. [•] TC 7, 61Pinna de genere concharum est corpusque rotundum habet. Mas et femina
socialiter ambulant. Aperit pinna conchas suas ad lunam seque parvis piscibus offert
quasi mortuam ; qui, protinus exultantes14assultantes 1536., ubi licentius15licentia VB.,
[•] VB 17, 79,
2sicut dictum est16Cette incise ne figure pas dans le texte de
Thomas de Cantimpré : il s’agit d’un ajout de Vincent de Beauvais,
conscient de dire deux fois la même chose en juxtaposant deux
marqueurs de citation., [•] TC 7, 61audacia
creverit17crevit VBd., implent18implet 1491
VB. ejus conchas. Mox vero pinna19pinnam
1491 Prüss1.,
se plenam sentiens, apprehensum20apprehensu 1536. quicquid incluserit exanimat21examinat 1491 Prüss1..
[3] [•] VB 17, 79, 3L’auteur. [•] VB 17, 79,
3La plays est un
poisson connu et courant – chez nous s’entend – et bicolore :
blanc sur un côté, noir sur l’autre. À son sujet, comme au sujet
de beaucoup d’autres poissons, je n’ai rien trouvé chez les
auteurs cités précédemment, à moins que ceux-ci ne les désignent
sous d’autres vocables que nous.
[3] [•] VB 17, 79, 3Actor. [•] VB 17, 79,
3Plays22plais 1536 VB. est piscis notus et usitatus –
apud nos23post nos hab. planus VB. scilicet – et24ut 1536.
bicolor25biculor 1491. : nam ex una parte albus, ex
altera niger. De quo, sicut26post sicut hab. et VB. de
pluribus aliis, nihil in praenominatis autoribus reperi, nisi
forte aliis nominibus vocentur ab eis quam a nobis.
~
1La pinna est ici la perna. Voir s. v.
Perna.
2La plais est probablement
la plie (Pleuronectes platessa Linné,
1758), citée à côté du passer par Peter
Artedi, Synonymia nominum piscium, 1738,
p. 30, parmi les Pleuronectes Linné, 1758.
Cependant, Pline (Plin. nat. 32, 150)
désigne ce poisson sous le nom de passer. Plais signifie la plie, selon Ueltschi 1994, 709,
dans sa traduction du Mesnagier de Paris :
« Plays [les plies] et quarrelet sont aucques d’une nature. La plus
grant est nommee plays, et la petite quarrelet, et est tavellee de
rouge sur le dos ; et sont bons du flo de mars et meilleurs du flo
d’avril. Affaictiez par devers le dos au dessoubz de l’oreille, bien
lavee, et mise en la paelle, et du sel dessus, et cuite en l’eaue
comme un rouget, et mengiez au vin et au sel ». En outre, il a dû
exister une homonymie pour la plais, car le
même nom désigne aussi le pecten selon
Vincent de Beauvais (VB 17, 99, 3), traitant de l’urtica. L’édition de Douai porte une note
marginale : Pecten id est plais gallice, « Le
pecten, c’est-à-dire, en français, le plais ». Voir Urtica,
ch. 102.
3Le
pinnotère ou pinnophylax est de fait un petit crabe, « gardien de
la pinne » : voir De Saint-Denis 1947, 87-88 ; D’Arcy Thompson
1947, 202.
4L’édition de 1536 a ajouté la suite du texte de
Pline : « Le guetteur, qui épiait ce moment, en avertit la pinne
par une légère morsure » (De Saint-Denis 1955, 83).
5Le mode
d’alimentation des pinnes (piégeage de petits poissons) est
fantaisiste.
~
1capitulum LXIX Prüss1 caput 69 1536.
2pinnotheren 1536
pinnotherem VB.
3pinophilacem 1491
pinnophylacem 1536 VBd.
4suilla
1491 Prüss1 VB.
5L’apparat de De Saint-Denis 1955 à Plin. nat. 9, 142 fait
état des variantes : squilla Barb. chilla codd. La leçon suilla (« truie », d’où l’illustration) de 1491
et de l’édition Prüss1 étant absurde, nous
avons opté pour squilla, de l’édition de
1536, conformément au texte de Pline (cité en note de sources),
bien que Vérard traduise par « suile ». Sur la squilla, voir De Saint-Denis 1947, 109 ; D’Arcy
Thompson 1947, 104.
6aliubi VB2 alicubi VBd.
7illi correximus ex Plin. : alii 1491 Prüss1 1536 VB.
8licentia VB.
9L’adverbe licentius, bien que fautif (voir Plin. nat. 9, 142-143, cité en note de
sources) n’est pas absurde ; aussi l’avons-nous conservé. Ubi licentia audacia crevit est ainsi traduit
par De Saint-Denis 1955, 83 : « enhardis par l’impunité du
piège ».
10post eam add. hoc tempus spiculatus (spec- Plin.) index, morsu levi
significat 1536 ex Plin.
11examinat 1491 Prüss1 VBd.
12Pline emprunte à Aristote (Arist. HA 547 b 15-18 et Arist. HA 547 b 25-28).
13La notice de Thomas de
Cantimpré est reprise presque à l’identique, à l’exception de
la phrase qui correspond à la fin du paragraphe de Pline cité
précédemment. Pline ne dit rien de l’accouplement du mâle et
de la femelle. Thomas de Cantimpré (comme Albert le Grand) a
dû prendre le pinnotère – comes de la
pinne – pour son mâle.
14assultantes 1536.
15licentia VB.
16Cette incise ne figure pas dans le texte de
Thomas de Cantimpré : il s’agit d’un ajout de Vincent de Beauvais,
conscient de dire deux fois la même chose en juxtaposant deux
marqueurs de citation.
17crevit VBd.
18implet 1491
VB.
19pinnam
1491 Prüss1.
20apprehensu 1536.
21examinat 1491 Prüss1.
22plais 1536 VB.
23post nos hab. planus VB.
24ut 1536.
25biculor 1491.
26post sicut hab. et VB.